3. Retouches et redimensionnements
Réflexions
Les images matricielles peuvent représenter des choses très différentes : la photographie d'un paysage ou d'un portrait, l'icône d'un objet, une image de fond (unie ou avec un dégradé de couleurs) ou encore une affiche contenant un mot, une page contenant un texte ou un mur rempli de hiéroglyphes.
 |  | 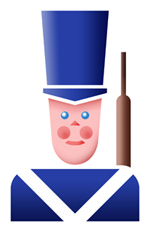 |
 |  | 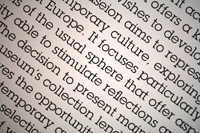 |
Pourtant, elles ont une caractéristique commune, elles sont constituées de pixels qui sont, chacun, d'une couleur bien définie.
Retoucher
Définir une image comme un ensemble de pixels nous aide à percevoir très simplement la retouche d'une image, quelle qu'elle soit, comme une modification de la couleur d'une partie de ses pixels (ou plus rarement, de tous ses pixels).
Dans les activités qui suivent, nous allons découvrir que les très nombreuses fonctionnalités des logiciels de dessin matriciel et de retouche d'image se ramènent toutes à ce principe simple.


Eh oui ! Qu'il s'agisse de gommer certains « défauts », de changer la couleur de l'arrière-plan d'une photo de passeport, de rendre une photo plus contrastée ou encore d'y intégrer une partie provenant d'une autre image, toutes ces manipulations qui peuvent paraître complexes consistent uniquement en des modifications de la couleur d'un nombre plus ou moins important de pixels.
Comprendre comment cela est possible va vous aider à travailler, retravailler, retoucher vos images avec davantage d'efficacité.
Redimensionner
Autre préoccupation : vous souhaitez modifier la taille d'une image (la réduire, l'agrandir, en extraire une partie).
Pour un système informatique, en quoi peuvent bien consister l'agrandissement et le rétrécissement d'une image ?
Il n'y a pas de mystère. Agrandir une image matricielle, c'est générer de nouveaux pixels. La rétrécir, c'est en supprimer.
Vous allez découvrir, au travers des activités qui suivent, comment cette génération et cette suppression ont lieu et quelles en sont les conséquences sur la qualité de l'image.